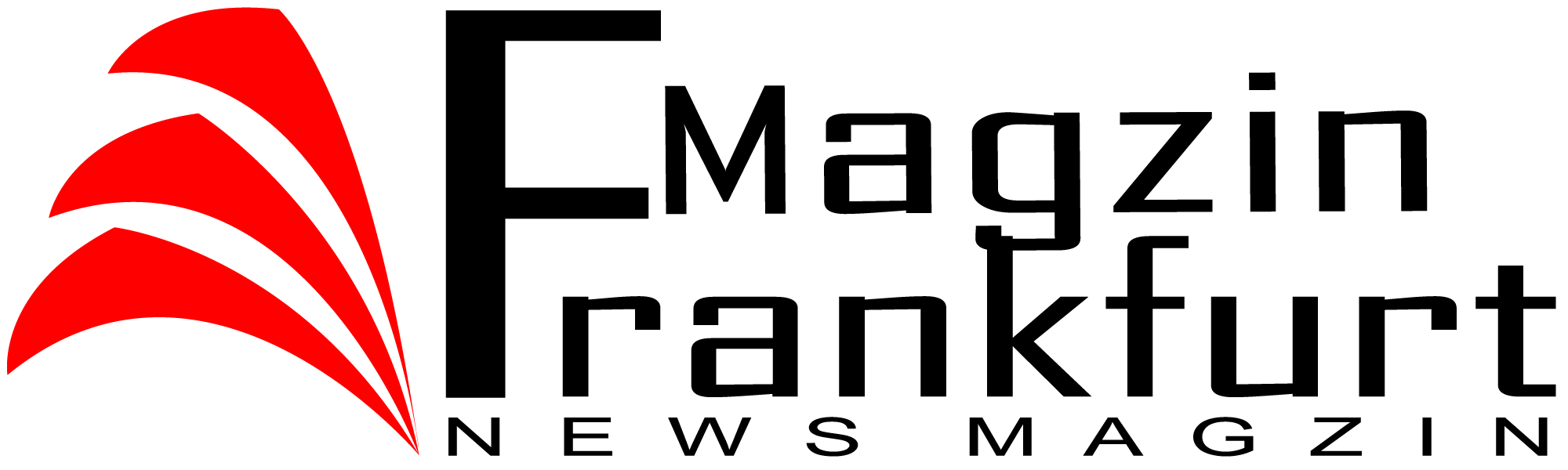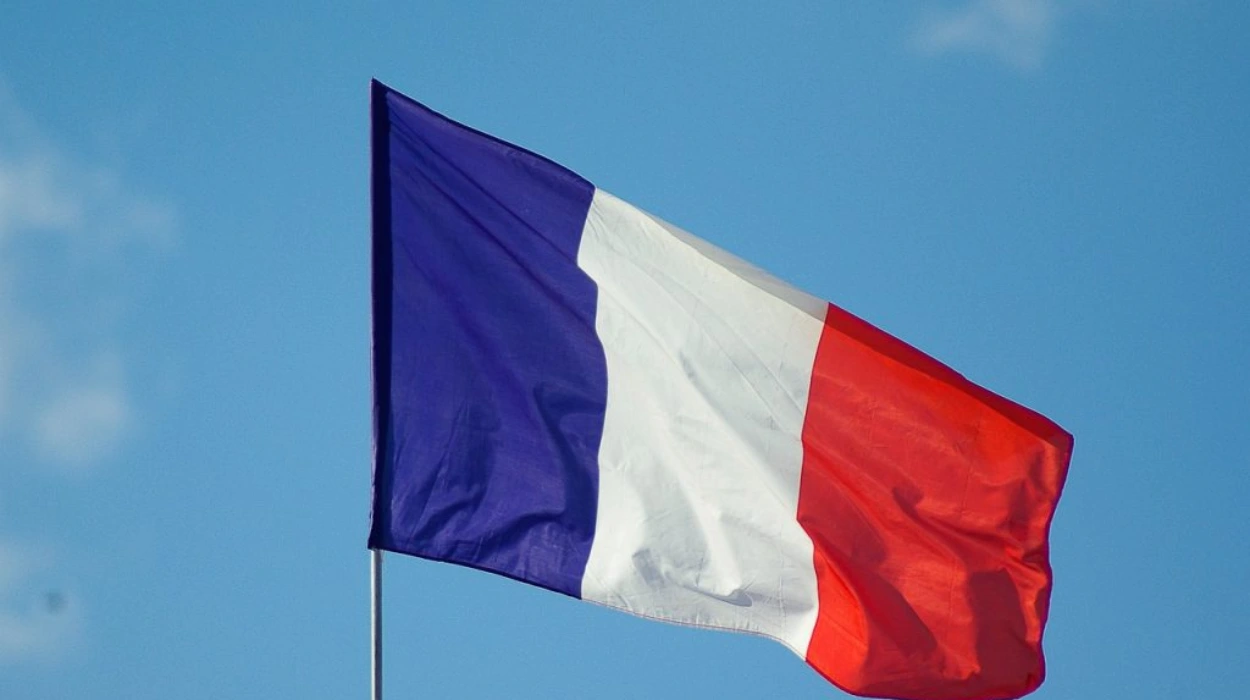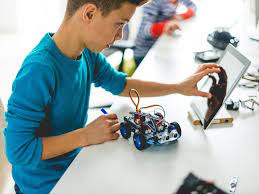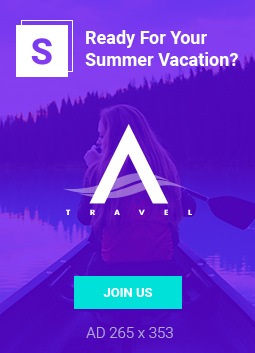La visite de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, au Sahara occidental le 17 février 2025 marque un tournant diplomatique majeur. Première personnalité gouvernementale française à se rendre dans ce territoire disputé, elle a officialisé la reconnaissance française de la souveraineté marocaine sur la région, provoquant une vive réaction d’hostilité de la part de l’Algérie. Ce déplacement s’inscrit dans la continuité de la politique française, qui, depuis juillet 2024, soutient le plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental. Retour sur les faits, les enjeux et les réactions suscitées par cette visite historique.
Une visite symbolique au cœur d’un conflit territorial
Un déplacement inédit au Sahara occidental
Le 17 février 2025, Rachida Dati s’est rendue à Laayoune, la plus grande ville du Sahara occidental, où vit environ 40 % de la population locale, ainsi qu’à Dakhla et Tarfaya, deux autres villes stratégiques sous contrôle marocain. Ce voyage officiel est une première pour un membre du gouvernement français, soulignant l’importance que Paris accorde à cette région.
Lors de son séjour, la ministre a inauguré la première mission culturelle française à Laayoune, avec notamment l’ouverture d’un centre culturel français. À Dakhla, elle a signé des accords de coopération dans les domaines du cinéma et de l’audiovisuel, et a annoncé la formation de quinze architectes marocains à l’École de Chaillot en France, renforçant ainsi les liens culturels et éducatifs entre la France et le Maroc.
Le Sahara occidental : un territoire au cœur d’un différend ancien
Le Sahara occidental, vaste territoire de 272 000 km², est majoritairement contrôlé par le Maroc (environ 70 %), tandis que le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, administre environ 30 % du territoire. Ancienne colonie espagnole, cette région est considérée par l’ONU comme un territoire non autonome dont le statut final doit être déterminé par un référendum d’autodétermination, toujours en suspens depuis 1991.
La France confirme sa position pro-marocaine
Un soutien politique affirmé
Depuis juillet 2024, la France a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, soutenant le plan d’autonomie proposé par Rabat comme « la seule base » pour résoudre le conflit. Cette position a été réaffirmée lors de la visite d’État du président Emmanuel Macron au Maroc en octobre 2024, où il s’est engagé à défendre cette ligne diplomatique au sein des Nations unies et de l’Union européenn.
Rachida Dati a qualifié sa visite de « moment historique » et de « geste politique fort », insistant sur le fait que « le présent et l’avenir de cette région s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Elle a également souligné l’importance de la coopération culturelle au bénéfice des populations locales, notamment des enfants et des étudiants.
Une diplomatie culturelle au service de la politique
La dimension culturelle de ce déplacement est au cœur de la stratégie française. En lançant des projets éducatifs et culturels, la France cherche à renforcer son influence dans la région tout en consolidant son alliance avec le Maroc. Cette démarche inclut notamment la création d’un centre culturel à Laayoune et la signature d’accords dans le secteur audiovisuel à Dakhla, illustrant une volonté d’ancrer durablement la présence française dans le territoire.
Une réaction algérienne virulente
Condamnation officielle et accusations
L’Algérie, principal soutien du Front Polisario, a vivement condamné la visite de la ministre française. Le ministère algérien des Affaires étrangères a qualifié ce déplacement de « dangereux » et « inacceptable », dénonçant une « violation flagrante du droit international » par un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Selon Alger, cette visite renforce « le fait accompli » marocain dans une région dont le processus de décolonisation reste « inachevé » et où le droit à l’autodétermination n’a pas été respecté.
Le gouvernement algérien a également accusé la France de « solidarité entre anciennes et nouvelles puissances coloniales », et a dénoncé une « mise à l’écart » des efforts onusiens visant à une résolution juste du conflit.
Des mesures diplomatiques et un climat tendu
En réaction, l’Algérie a suspendu ses relations avec le Sénat français après la visite de son président Gérard Larcher à Laayoune, qu’elle a jugée « contraire aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU ». Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé son soutien indéfectible au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, insistant sur le fait que la position algérienne restera inchangée tant que ce droit ne sera pas pleinement reconnu.
Par ailleurs, la polémique a pris une dimension politique et médiatique, avec des attaques personnelles contre la ministre Dati, notamment de la part de députés français d’origine algérienne, illustrant la sensibilité du sujet au sein même de la classe politique française.
Enjeux géopolitiques et perspectives
Un conflit toujours non résolu
Le Sahara occidental demeure l’un des derniers conflits territoriaux majeurs en Afrique. Malgré la présence d’une mission de maintien de la paix de l’ONU depuis plus de trois décennies, le référendum promis n’a jamais eu lieu, en raison du refus marocain d’inclure l’indépendance comme option. La position française, en soutenant le plan d’autonomie marocain, s’inscrit dans une logique de compromis politique, mais elle est perçue comme un alignement sur Rabat au détriment des aspirations sahraouies.
La France entre influence et controverse
La visite de Rachida Dati illustre la volonté de la France de renforcer ses liens avec le Maroc dans un contexte régional tendu, tout en affirmant son rôle diplomatique au Sahara occidental. Toutefois, cette démarche a ravivé les tensions avec l’Algérie, un pays clé en Afrique du Nord, dont la coopération est essentielle pour la stabilité régionale.
La controverse souligne également les défis auxquels la France est confrontée pour concilier ses intérêts stratégiques, ses engagements internationaux et les sensibilités politiques liées à son passé colonial et à sa diaspora.