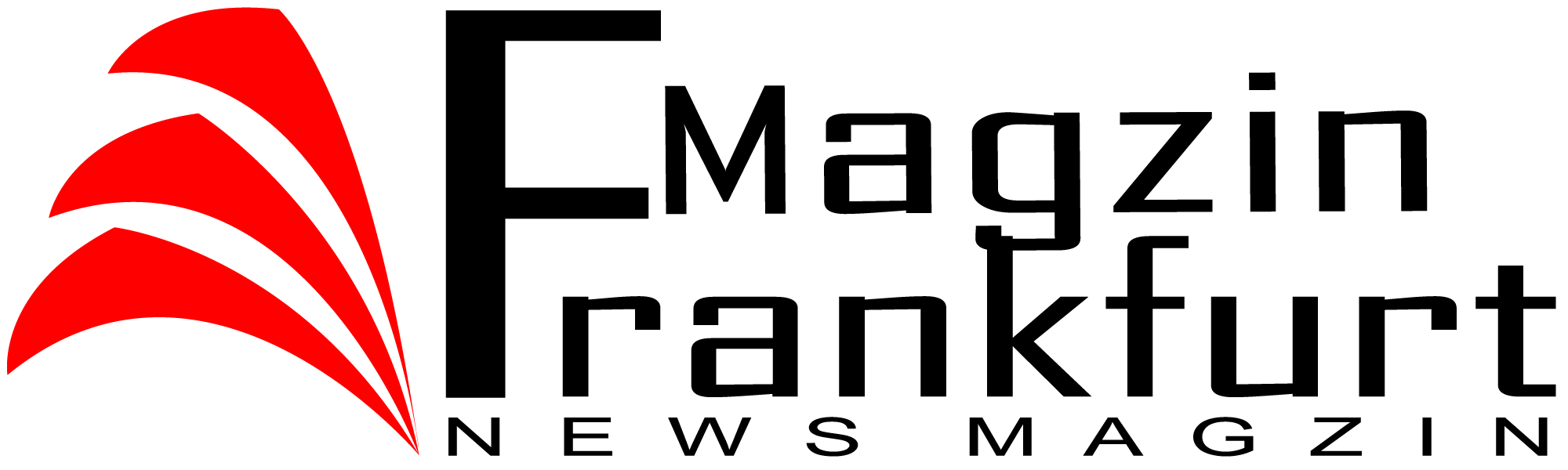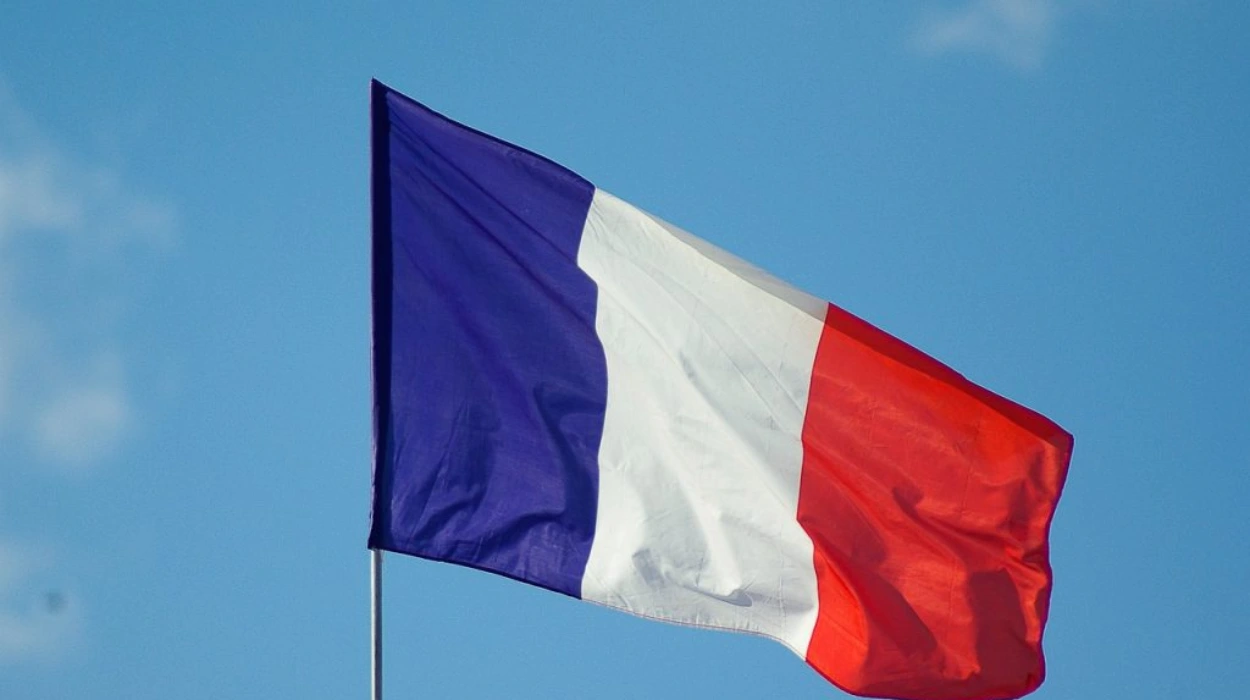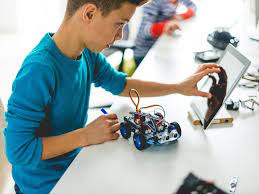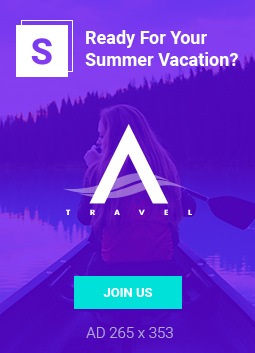Les relations entre l’Algérie et la France traversent une crise diplomatique majeure en 2025, révélant des fractures plus profondes que le simple refus d’expulsions. Depuis début 2025, plusieurs arrestations de ressortissants algériens en France, suivies d’un bras de fer sur des listes d’expulsions refusées par Alger, ont précipité un conflit dur entre les deux pays. Cette situation s’inscrit dans un contexte plus large de tensions politiques, historiques et sociales qui menacent une rupture irréversible. Retour détaillé sur les faits, les déclarations officielles et l’arrière-plan qui alimentent cette crise.
Arrestations et expulsions contestées, point de départ du conflit
En janvier 2025, plusieurs Algériens résidant en France ont été arrêtés pour leurs activités supposées d’incitation à la haine et à la violence anti-oppositionalgérienne sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Boualem Naman, arrêté le 5 janvier, expulsé de France puis refoulé par Alger, créant un incident diplomatique autour d’un « jeu humiliant » selon Paris.
Simultanément, Abdelwakil Blamm, critique du régime algérien, a été arrêté en France pour accusations liées au terrorisme et à la diffusion de fausses informations, ce qui alimente le sentiment d’une répression ciblant les opposants politiques.
En novembre 2024 déjà, l’écrivain francophone Boualem Sansal, connu pour ses critiques du pouvoir algérien et ses propos controversés sur le Sahara Occidental, a été arrêté en Algérie pour « menaces à la sécurité nationale ». Le président Abdelmajid Tebboune l’a qualifié d’« imposteur envoyé par la France pour déstabiliser l’Algérie ».
Ces évènements illustrent une atmosphère d’accusations mutuelles où la fracture politique domestique alimente l’internationalisation des tensions.
Refus algérien d’accepter les déportés : un bras de fer diplomatique
Le point d’orgue de la crise s’est produit le 17 mars 2025 lorsque l’Algérie a catégoriquement refusé d’accueillir une liste d’environ 60 ressortissants algériens que la France souhaitait expulser. Ces individus sont décrits en France comme « perturbateurs de l’ordre public » ou « profils dangereux » par le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau.
Alger a dénoncé cette démarche comme une « intimidation » et un acte de coercition violant le droit consulaire. Dans un communiqué officiel, l’Algérie a réaffirmé son devoir de protection de ses ressortissants et rejeté les menaces et ultimatums émanant de Paris.
Retailleau a annoncé une réponse graduée, envisagée sous forme de sanctions ciblées et de suspension d’accords bilatéraux, notamment la suspension d’un accord de 2007 permettant aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens de se rendre en France sans visa. Ces mesures marquent une montée d’escalade sans précédent.
Réactions politiques en France : divergences et tensions internes
En France, cette crise provoque un large éventail de réactions au sein du spectre politique. À gauche radicale, Rima Hassan, députée européenne, accuse le gouvernement de permettre le délitement des relations en manquant de fermeté et appelle à la démission de Retailleau.
À l’extrême droite, Marine Le Pen et Jordan Bardella dénoncent un gouvernement « faible » et demandent une politique plus dure envers l’Algérie, estimant que la population française ne comprendrait pas une inaction face à ce qu’ils qualifient de provocations répétées qui pourraient contrevenir aux accords bilatéraux historiques.
Ces positionnements témoignent des enjeux électoraux et identitaires français exacerbés par la crise algéro-française.
Enjeux historiques et géopolitiques : au-delà des faits immédiats
Cette confrontation doit être replacée dans un contexte plus large qui dépasse le seul litige consulaire. La reconnaissance par la France en juillet 2024 de la souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental a été perçue par Alger comme un acte « inattendu, maladroit et contreproductif », exacerbant ses griefs contre Paris.
La mémoire non résolue de la colonisation reste une source majeure d’amertume algérienne, notamment face à une histoire enseignée en France qui valorise encore certains apports du colonialisme, provoquant colère et rejet en Algérie.
Plus de 10% de la population française est issue ou liée à l’Algérie, avec environ 900 000 double-nationaux, ce qui complexifie encore les relations humaines, migratoires et sociales entre les deux pays.
Par ailleurs, des enjeux régionaux comme la coopération énergétique, la sécurité en Méditerranée et la gestion conjointe des catastrophes naturelles (les incendies dévastateurs qui détruisent des centaines de milliers d’hectares chaque été) donnent à ces relations un enjeu stratégique crucial.
Risques d’une rupture durable et appel à la raison
Les experts, notamment de l’Atlantic Council, soulignent le risque d’une rupture « irréversible » si ce conflit larvé n’est pas traité avec soin. La méfiance mutuelle, le jeu diplomatique en interne et l’évolution politique en Algérie, avec une colère populaire contre la France grandissante, complexifient la recherche de solutions à court terme.
Pour l’heure, les deux pays restent liés par une histoire et des intérêts communs profonds, rendant souhaitable un retour au dialogue. Mais la fragilité de cet équilibre exige sans doute un repositionnement des deux gouvernements afin d’éviter une escalade aux conséquences économiques, sociales et symboliques lourdes.